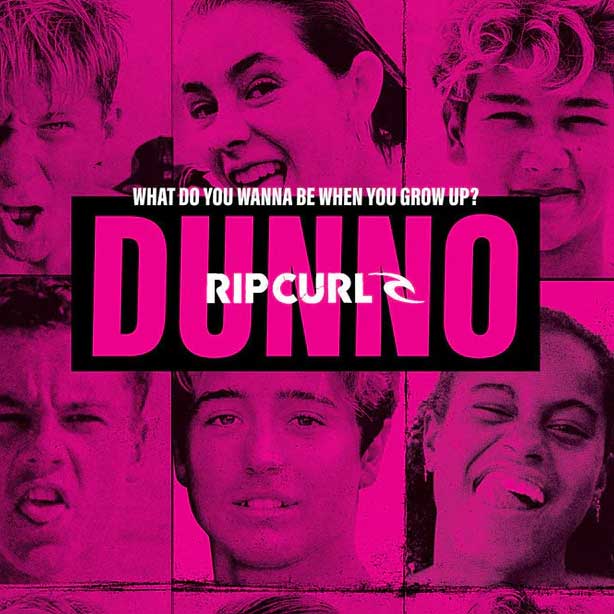The Search: Iron Horse

Un voyage aux confins escarpés de la Terre
À la recherche des chasseurs de dalles sud-américains Bruno Santos et Guillermo Satt.
Nous sommes au milieu du Pacifique, sur un rocher volcanique, frappés par une houle colossale. On est aussi isolés qu'on peut l'être.
C'est le photographe australien Ted Grambeau qui parle. Si vous connaissez Ted Grambeau, vous entendrez le son de sa voix grave, rauque, vaguement erratique ; le volume monte à chaque syllabe, le débit ralentit à chaque mot, chaque phrase s'éternise jusqu'à presque ressentir leur isolement.
Cet endroit… le surf… ce n'est pas pour les âmes sensibles. Si nous y allons, c'est pour trouver des vagues parmi les plus impressionnantes du monde. C'est isolé, c'est dangereux, et nous serons à la limite. – Ted Grambeau
Deux jours avant cette explosion de voix, Ted avait appelé le siège de Rip Curl. Il avait dit connaître un endroit, et que cet endroit allait être complètement déferlé. Les vents étaient bons. La direction importait peu. Seul comptait le voyage de deux jours, et le temps pressait.
Si l'appel avait été lancé par quelqu'un d'autre, un autre photographe passionné souhaitant partir en voyage, la réponse aurait été non. Mais c'est Ted qui l'a lancé, et de tous les photographes du monde, Ted est le meilleur quand il s'agit de savoir de quoi il parle. Il a passé la majeure partie des trente dernières années à cartographier les vagues, à observer les cartes et à apprendre à connaître l'océan.
« On ne peut pas y aller avec n'importe qui », dit-il. « Cet endroit… le surf… ce n'est pas pour les âmes sensibles. Si on y va, c'est pour trouver des vagues parmi les plus impressionnantes. C'est isolé, c'est dangereux, et on sera à la limite. »
Deux athlètes Rip Curl étaient parfaits pour ce poste : le Brésilien Bruno Santos, 34 ans, et le Chilien Guillermo Satt, 24 ans. Les deux hommes se connaissent depuis dix ans, non seulement comme coéquipiers chez Rip Curl, mais aussi comme compagnons de voyage, ayant passé des mois ensemble à chasser les grosses vagues en Amérique du Sud et dans les régions périphériques.
Bruno s'est fait connaître en surf de grosses vagues en remportant Teahupo'o grâce à sa participation aux sélections. Depuis, il poursuit sa carrière de chercheur à temps plein, s'attaquant à des vagues toujours plus lourdes et plus isolées à chaque sortie. Guillermo, dix ans plus jeune, commence tout juste à suivre les traces de son ami.
Ainsi, en moins de 48 heures, Bruno, Guillermo, Ted et le vidéaste Jon Frank sortaient d'un minuscule aéroport, sur une île minuscule au milieu de nulle part. Dès qu'ils ouvrirent les portes, ils furent accueillis par un vent vif et une légère bruine. Ils serrèrent la main de leur contact, un marin local du nom d'Alemao, et entamèrent le début d'une aventure navigant sur des vagues parmi les plus terrifiantes et les plus enrichissantes de leur vie.
« Il y avait une énorme impatience avant ce voyage », raconte Ted, se remémorant encore ces souvenirs trois mois plus tard. « C'était presque un drame étrange, car une fois qu'on voit la côte, on comprend où l'on est. C'est probablement la côte la plus fréquentée que j'aie jamais vue, et elle n'est absolument pas agréable à naviguer. »
D'un côté de l'île s'étend une vaste baie parfaite, bordée par une falaise abrupte plongeant dans l'océan. Une vague court au pied des falaises, puis vire et déferle sur la baie. Lorsqu'elle prend de l'ampleur, elle peut former une plaque sèche de 3,6 mètres, l'une des plus belles vagues que les garçons ont trouvées. Éclipsée par la montagne volcanique environnante, c'est une gauche parfaite comme une carte postale.
« Ça n'a pas l'air aussi impressionnant jusqu'à ce qu'on y mette un humain pour référence », explique Ted. « Les petits points sur la colline que l'on prend pour des rochers sont en fait des vaches et des chevaux. Quand on s'en rend compte, on réalise l'ampleur réelle de la houle. On a vite découvert que des vagues de 1,80 m faisaient en réalité 3 à 3,60 m, et qu'elles déferlaient sur la pointe. »
Aussi belle soit-elle, la vague n'est pas sans obstacles, et avec eux, ses conséquences. L'entrée dans l'eau est délicate, potentiellement mortelle. « Il y a un saut de falaise de six mètres pour atteindre l'océan », explique Ted, « puis il faut traverser la baie, qui, si elle est grande, peut être complètement fermée. Ensuite, pour revenir, il faut escalader cette même paroi rocheuse, en synchronisant son attaque entre les séries. C'est fou, et réservé aux surfeurs expérimentés. Il y a beaucoup de surfeurs sur le World Tour, la plupart, en fait, qui ne seraient pas à l'aise là-bas. »
Ajoutez à la nature intempérante du paysage une déconnexion marquée avec le monde extérieur, et vous vous retrouvez dans une situation périlleuse et à haut risque. Tout ce qui se passe sur cette île est décuplé par un degré de lourdeur et d'intensité.
Comme Bruno l'a si bien dit à l'équipage après une séance un jour : « Les médecins devraient mettre des moniteurs cardiaques aux surfeurs qui pagayent ici ! Ce n'est pas mou ! »
L'autre côté de l'île ne fait pas exception. La plupart des endroits, même aux confins de l'océan Pacifique, attirent des tempêtes de différentes directions – houles venant de Nouvelle-Zélande ou descendant du Mexique – mais pas ici. Cet endroit est particulièrement frappé par presque toutes les hautes et basses mers qui traversent le Pacifique.
« On ne surfe que lorsque le vent souffle du nord », explique Ted. « On a eu ça deux ou trois fois pendant notre voyage, mais certains jours, c'était vraiment trop – des fosses mortelles de 4,5 mètres. L'île entière offrait un choix presque pléthorique – sauf que le choix n'est pas de savoir sur quelle vague on veut se faire écraser, mais plutôt sur quelle vague on veut se tuer. C'est plus grand que Tahiti ici et on y reçoit l'une des houles les plus directes au monde. »
C'est ainsi que Ted a découvert cet endroit : sur Google Earth, en suivant simplement la direction de la houle et en observant qui en subit les conséquences. C'est peut-être pour cela que cette île, cet endroit, est si préservé : nous n'avons eu la technologie et la capacité de suivre la houle avec autant d'acuité que pendant une période relativement courte.
« J'étudie la houle depuis plus de 30 ans », explique Ted. « Mais depuis l'arrivée des cartes de houle, nous pouvons enfin la suivre jusqu'à sa disparition complète. Auparavant, il fallait consulter une carte synoptique, généralement réservée aux endroits connus – Indonésie, Tahiti, ou quelque chose de ce genre. On ne suivait jamais la houle et on ne savait jamais où elle allait après avoir touché ces endroits. »
C'est désormais beaucoup plus clair partout dans le monde, et je pense que cela explique en grande partie pourquoi tant de gens s'éloignent des zones traditionnelles pour se diriger vers des endroits où la houle est la plus forte. On se dit : "Oh là là, ce petit affleurement volcanique est exactement au même niveau que l'une des plus grosses houles du monde !" Il y a toute une série d'îles qui sont constamment frappées par la houle, et il suffit alors de trouver le bon timing pour qu'elles coïncident avec les vents optimaux. Tout est très cyclique, mais il faut trouver la combinaison parfaite. Les prévisions se sont tellement améliorées qu'un raid peut avoir de grandes chances d'être réussi, avec un préavis très court, comme ce voyage.
Après chaque voyage, il est inévitable que vous regardiez en arrière et que vous compariez vos idées préconçues sur les vagues, la culture et le lieu avec la réalité de ce que vous avez trouvé – là où vos attentes ont été satisfaites et là où la réalité n'a pas été à la hauteur.
Ted aborde ce sujet…
C'est drôle. Je parlais d'attentes, mais elles sont rarement comblées ou dépassées. C'était l'un de ces rares cas. Surfer dans un environnement riche et imprégné de culture a quelque chose de spécial : cela ajoute une touche d'originalité à un voyage. On a l'impression que c'est bien plus que des vagues : c'est un sentiment d'appartenance, une culture. C'est une expérience extraordinaire par son énergie et son ampleur, et cela se reflète clairement dans l'océan.
Forts vents de terre. Falaises abruptes et déchiquetées. Dalles de 3,6 mètres de haut. Un océan puissant et inconnu. Un troupeau de chevaux blancs se tenant sur la lave volcanique durcie. Aucun signe. Aucun point de repère. Juste des éléments bruts. C'est là que l'équipe s'est retrouvée, et c'est cet environnement qui a façonné la culture du lieu qu'elle a temporairement habité.
On arrivait sur le rivage et la femme du voisin préparait un barbecue. On s'asseyait sur les rochers pour manger du poisson jusqu'au coucher du soleil, parfois sans même dire un mot. C'était un spectacle magnifique et authentique. Ce sont ces moments-là qui créaient la magie du lieu – la confrontation entre les éléments rudes et les gens qui y survivent.
« Ce n'était pas ça. C'était un voyage. Un vrai voyage. Et à mon humble avis, cet idéal est menacé. »
Tous ceux qui ont voyagé, tous ceux qui ont surfé, savent que tout est une question de voyage. C'est peut-être pour cela qu'un voyage comme celui-ci… sur une île au milieu du Pacifique, sur un rocher volcanique, frappé par une houle énorme, aussi isolé que possible… est si important.
Cela maintient la recherche en vie, depuis les extrémités accidentées de la terre.